Les Manuscrits de Tagdemt
Le Château de Chantilly a organisé au printemps dernier une exposition inédite de 38 manuscrits en langue arabe, rassemblés par le chef militaire et savant Abd el-Kader et destinés à rejoindre sa bibliothèque de Tagdemt en Algérie. Henri d’Orléans, duc d’Aumale, s’en empare en 1843 lors de la prise de la smalah à Taguin et ces manuscrits rejoignent donc ainsi les collections du bibliophile que les fait restaurer et en entreprend l’étude. Pour nos yeux qui se représentent assez bien la physionomie d’un manuscrit occidental, la vue de ces textes majoritairement du 18e siècle, à l’écriture « gracile et courbe », protégés dans des reliures à rabat qui montrent tout le savoir-faire des artisans maroquiniers arabes fascinent. Témoins de l’érudition de leur ancien possesseur, Abd el-Kader, le même qui fut prisonnier au château d’Amboise pendant quatre années, ils nous incitent à prendre le temps de réfléchir à leur destin d’exilés géopolitiques dans les conflits coloniaux du 19e siècle mais surtout de les découvrir comme témoins d’une riche culture à la fois religieuse et savante
Les Manuscrits de Tagdemt
Le Château de Chantilly a organisé au printemps dernier une exposition inédite de 38 manuscrits en langue arabe, rassemblés par le chef militaire et savant Abd el-Kader et destinés à rejoindre sa bibliothèque de Tagdemt en Algérie. Henri d’Orléans, duc d’Aumale, s’en empare en 1843 lors de la prise de la smalah à Taguin et ces manuscrits rejoignent donc ainsi les collections du bibliophile que les fait restaurer et en entreprend l’étude. Pour nos yeux qui se représentent assez bien la physionomie d’un manuscrit occidental, la vue de ces textes majoritairement du 18e siècle, à l’écriture « gracile et courbe », protégés dans des reliures à rabat qui montrent tout le savoir-faire des artisans maroquiniers arabes fascinent. Témoins de l’érudition de leur ancien possesseur, Abd el-Kader, le même qui fut prisonnier au château d’Amboise pendant quatre années, ils nous incitent à prendre le temps de réfléchir à leur destin d’exilés géopolitiques dans les conflits coloniaux du 19e siècle mais surtout de les découvrir comme témoins d’une riche culture à la fois religieuse et savante
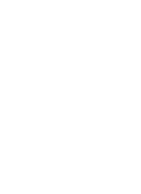




 Votre compte
Votre compte
