Sydney Lumet - Dans le sens de la marge
LivreDisponible
Veuillez vous connecter pour réserver
Sydney Lumet - Dans le sens de la marge
Année de parution :
2011
p.2-150
Note générale : Encore trop souvent considéré comme un habile faiseur de fictions de gauche , Sidney LUMET est pourtant l'auteur d'une oeuvre très originale et abondante, que l'on ne cesse de redécouvrir avec un intérêt croissant depuis la sortie de son dernier film, "7h58 ce samedi-là" (2007), lequel avait alors marqué le retour en grâce du cinéaste sur les écrans, après une période d'inactivité longue de sept années. Décédé le 09 avril 2011, peu après la ressortie en salles de plusieurs de ses grands films des années 70 ("Serpico", 1973 ; "Un après-midi de chien", 1975 ; "Network", 1976) et de quelques chef-d'oeuvres oubliés ("The Offence", 1972 ; "A bout de course", 1988), Sidney Lumet aura signé 44 longs métrages réalisés sur plus d'un demi-siècle de carrière, lesquels composent une filmographie aussi dense que finalement méconnue, qui invite aujourd'hui au réexamen autant qu'à la réévaluation. Cinéaste de studio au double sens du terme (il tourne pour les major companies et demeure l'un des maîtres du huis-clos depuis son premier film, "Douze hommes en colère", 1957), Lumet est un insider qui n'a pourtant jamais cessé d'aller dans le sens de la marge , que l'on considère ses protagonistes ou les choix d'écriture très audacieux qu'il est parvenu à imposer, y compris dans les cadres a priori les plus rigides. Particulièrement conscient de son statut au sein du système, Lumet l'aborde sans détours et de façon très pragmatique, par le truchement de la question du style notamment, à laquelle il consacre d'ailleurs un chapitre entier du livre qu'il écrit en 1995 et intitule sobrement "Faire des films" (Making Movies ). Si l'on a parfois reproché à Sidney Lumet d'être trop difficile à reconnaître , c'est précisément en vertu de cette haute exigence qu'il place en son art, laquelle considère la manière non comme primat mais comme expérience unique, recherche perpétuelle et appropriation distinctive d'une matière, d'un sujet, d'un contenu choisi, élu. Le style, en somme, ce n'est pas l'homme, c'est le cinéaste au travail, dont la capacité d'expression ne saurait se confondre avec la simple volonté de revendication.
Note Contenu : "Fides, et anima, unde abiit eo nunquam redit" (Sur le thème de la confiance) par Franck Boulègue, p.132-143.
Croire en l'homme ("Le Gang Anderson", 1971 ; "Serpico", 1973 ; "Un après-midi de chien", 1975 ; "Le Prince de New York", 1981) par Luc Duvinage, p.90-97.
Ethique et esthétique de la direction d'acteur ("L'homme à la peau de serpent", 1959) par Christian Viviani, p.18-25.
Examen de conduite ("7h58 ce samedi-là, 2007) par Violaine Caminade de Schuytter, p.112-123.
I. Sur le métier : le travail du cinéaste : "Style" : le terme le plus galvaudé depuis le mot "amour" par Sidney Lumet, p.1-17.
II. Engagements : L'homme et le système ("Le Gang Anderson", 1971 ; "Serpico", 1973 ; "Un après-midi de chien", 1975 ; "Network", 1976 ; "Le Prince de New York", 1981) par Arnaud Devillard, p.46-53.
III. VIsion du monde et vision du cinéma : "Un procès, douze braves gens", c'est une excellente institution" ("Douze hommes en colère", 1957 ; "Le crime de l'Orient-Express", 1974) par Yann Calvet, p.80-89.
IV. Chemin faisant : Regarde les hommes tomber (Antihéros et perdants magnifiques) par Damien Detcheberry, p.124-131.
La griffe du passé ("Le Prêteur sur gages, 1964) par Michaël Delavud, p.98-103. Le Matador et la pepperoni ("Point limite", 1964) par Jérôme Lauté, p.104-111.
La télévision à l'ère du spectacle ("Network", 1976) par Sébastien Denis. Générations perdues ("Daniel", 1983 ; "A bout de course", 1988) par Valentin Noël, p.62-71.
La voix de la colère et du doute (Un cinéaste face à son public et à son pays) par Pierre-Simon Gutman, p.144-150.
Le montage comme figure du ressassement traumatique ("The Offense", 1972) par Céline Saturnino et Rémi Gonzalez, p.36-45.
Melpomène à New York (Modernité du jeu tragique) par Christophe Damour, p.26-35.
Plusieurs articles : A pied d'oeuvre par Youri Deschamps, p.2-9.
Tracer la route ("A bout de course", 1988, Analyse de la séquence d'ouverture) par Bruno Follet, p.72-79.
Croire en l'homme ("Le Gang Anderson", 1971 ; "Serpico", 1973 ; "Un après-midi de chien", 1975 ; "Le Prince de New York", 1981) par Luc Duvinage, p.90-97.
Ethique et esthétique de la direction d'acteur ("L'homme à la peau de serpent", 1959) par Christian Viviani, p.18-25.
Examen de conduite ("7h58 ce samedi-là, 2007) par Violaine Caminade de Schuytter, p.112-123.
I. Sur le métier : le travail du cinéaste : "Style" : le terme le plus galvaudé depuis le mot "amour" par Sidney Lumet, p.1-17.
II. Engagements : L'homme et le système ("Le Gang Anderson", 1971 ; "Serpico", 1973 ; "Un après-midi de chien", 1975 ; "Network", 1976 ; "Le Prince de New York", 1981) par Arnaud Devillard, p.46-53.
III. VIsion du monde et vision du cinéma : "Un procès, douze braves gens", c'est une excellente institution" ("Douze hommes en colère", 1957 ; "Le crime de l'Orient-Express", 1974) par Yann Calvet, p.80-89.
IV. Chemin faisant : Regarde les hommes tomber (Antihéros et perdants magnifiques) par Damien Detcheberry, p.124-131.
La griffe du passé ("Le Prêteur sur gages, 1964) par Michaël Delavud, p.98-103. Le Matador et la pepperoni ("Point limite", 1964) par Jérôme Lauté, p.104-111.
La télévision à l'ère du spectacle ("Network", 1976) par Sébastien Denis. Générations perdues ("Daniel", 1983 ; "A bout de course", 1988) par Valentin Noël, p.62-71.
La voix de la colère et du doute (Un cinéaste face à son public et à son pays) par Pierre-Simon Gutman, p.144-150.
Le montage comme figure du ressassement traumatique ("The Offense", 1972) par Céline Saturnino et Rémi Gonzalez, p.36-45.
Melpomène à New York (Modernité du jeu tragique) par Christophe Damour, p.26-35.
Plusieurs articles : A pied d'oeuvre par Youri Deschamps, p.2-9.
Tracer la route ("A bout de course", 1988, Analyse de la séquence d'ouverture) par Bruno Follet, p.72-79.
Disponibilité Section Médiathèque Localisation Cote
Consultable sur place Patrimoine - Touraine Bibliothèque Centrale Magasin 2e sous-sol Per 122
Disponible Adultes Bibliothèque des cinémas studio 791.434.1 LUM
0 commentaires
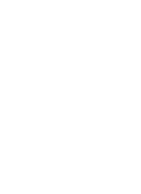




 Votre compte
Votre compte
